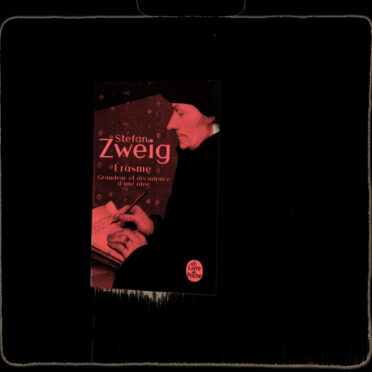 Ce titre en latin issu des « Adagia » d’Érasme signifie que « la guerre est douce à ceux qui l’ignorent ». Elle est d’autant plus d’actualité que ceux qui en nourrissent la perspective sont rarement prêts à enfiler l’uniforme. Toujours est-il qu’à la fin du 15e siècle et dans les années du suivant, les beaux esprits s’en allaient piocher dans le dictionnaire des citations latines sélectionnées par Érasme, afin de briller dans les dîners en ville. Le latiniste distingué qu’était le prêtre de Rotterdam, puis l’un des plus grands esprits d’Europe, savait cela. Tout ce qui venait de son moi spirituel était bon à prendre. Stefan Zweig, dans sa puissante biographie d’Érasme, notait déjà en 1935 que le besoin de truffer une intervention orale ou écrite de quelques mots de latin, était toujours fort partagé. Comme une drogue irrésistible qui faisait dire à quelque convive voisin d’un quelconque orateur: « diable, quel personnage instruit. » Cette biographie se rappelle doublement à nous. D’abord parce qu’Érasme (1467-1536) ne prônait pas que la tolérance entre les hommes, il conseillait également et sans se lasser, l’instrument diplomatique, le chemin de la conciliation ou la voie du compromis afin d’éviter qu’une situation dégénère en conflit incontrôlable. Et d’autre part parce que la parution de cette biographie par Zweig (1881-1942) fut publiée en pleine montée du nazisme. Elle tombait à pic, mais sur le plan pratique, elle fit malheureusement plouf.
Ce titre en latin issu des « Adagia » d’Érasme signifie que « la guerre est douce à ceux qui l’ignorent ». Elle est d’autant plus d’actualité que ceux qui en nourrissent la perspective sont rarement prêts à enfiler l’uniforme. Toujours est-il qu’à la fin du 15e siècle et dans les années du suivant, les beaux esprits s’en allaient piocher dans le dictionnaire des citations latines sélectionnées par Érasme, afin de briller dans les dîners en ville. Le latiniste distingué qu’était le prêtre de Rotterdam, puis l’un des plus grands esprits d’Europe, savait cela. Tout ce qui venait de son moi spirituel était bon à prendre. Stefan Zweig, dans sa puissante biographie d’Érasme, notait déjà en 1935 que le besoin de truffer une intervention orale ou écrite de quelques mots de latin, était toujours fort partagé. Comme une drogue irrésistible qui faisait dire à quelque convive voisin d’un quelconque orateur: « diable, quel personnage instruit. » Cette biographie se rappelle doublement à nous. D’abord parce qu’Érasme (1467-1536) ne prônait pas que la tolérance entre les hommes, il conseillait également et sans se lasser, l’instrument diplomatique, le chemin de la conciliation ou la voie du compromis afin d’éviter qu’une situation dégénère en conflit incontrôlable. Et d’autre part parce que la parution de cette biographie par Zweig (1881-1942) fut publiée en pleine montée du nazisme. Elle tombait à pic, mais sur le plan pratique, elle fit malheureusement plouf.
En 1935, les odeurs de soufre lui montant au cerveau par les narines ne lui disaient donc rien qui vaille. Tout se mettait en place comme au temps d’Érasme. L’intellectuel cédait le pas aux bateleurs, aux sectateurs, aux diffuseurs de haine, aux maîtres queux du désordre. La guerre devenait une hydre qui voulait ardemment une large part de sang. Pas des discussions gentilles ou des analyses abstraites se succédant les unes aux autres, comme on en voit trop aujourd’hui sur les plateformes d’information télévisuelles.
Zweig avait dû sentir l’opportunité de ressortir du passé ce sage qu’était Érasme, personnage érudit, amoureux des lettres, ayant abandonné sa langue natale pour le latin. C’était trop tard, mais c’était bien tenté. Zweig s’appliqua tout de même à mettre toute son intelligence, toute sa sagacité, toute sa pertinence au service d’un portrait qu’en 2025, on ferait bien de relire, sans compter son écriture implacable de justesse.
L’ouvrage est génial. On y sent l’admiration de l’auteur pour le penseur, lequel ne se sentait jamais autrement mieux qu’à Bâle, la ville suisse dont il fit longtemps son refuge. Mais on comprend aussi, petit à petit, qu’il déplorait la poltronnerie d’Érasme, son refus de s’engager pour un camp ou pour un autre. Ce qui lui permettait à ses débuts, d’éviter le bûcher facilement réservé aux hérétiques. Plus tard il continua de louvoyer finement afin de ne pas se fâcher avec les protagonistes du grand conflit religieux qui allait s’ouvrir en Europe entre les catholiques et les protestants.
Son destin contraire avait toutefois trouvé la parade. Car, écrit Zweig, il est « bien rare que le destin et la mort, ces puissances suprêmes, nous rendent visite sans nous avoir avertis. Elles se font toujours précéder d’un messager discret, au visage voilé, et dont la plupart du temps le mystérieux signal nous laisse indifférents ». Lorsqu’il reçut, datée du 11 décembre 1516, une lettre d’un certain Spalatin lui parlant d’un moine obscur du nom de Martin Luther, Érasme n’y prêta pas attention. Erreur puisque d’un « doigt léger » avec sa nouvelle doctrine évangélique enjambant insolemment le pape, ce Luther qui vint toquer à la porte, serait bientôt vu écrit Zweig, d’abord comme un successeur puis comme un vainqueur. Qui n’hésitera pas, littéralement et passé le temps des correspondances déférentes, à conchier Érasme, à proférer avec sa grossièreté légendaire, excitant les foules, qu’il se torchait même avec vigueur du papier où son concurrent couchait sa prose raffinée. Il était fort lui, ne s’évanouissait pas à la vue du sang et s’abreuvait de bière de Wittenberg tandis qu’Érasme soignait la faiblesse de son métabolisme avec du vin de Bourgogne. Il allait se faire écraser par ce Luther, lequel recommandait l’intolérance au contraire de ce qu’avait prescrit Érasme dans son « Éloge de la folie ». Se faire laminer par ce tribun anti-sémite en plus d’être anti-catholique, écrivant avec une violence grasse, que « pour l’amour du bien et pour le plus grand profit de l’Église », il ne fallait pas « avoir peur de dire un bon gros mensonge« .
Tellement d’actualité cette biographie d’Érasme, celle racontant la vie d’un homme œcuménique, épris de paix, d’intelligence, mais finalement défait. Vaincu par la culture méthodique de la haine de l’autre.
PHB

