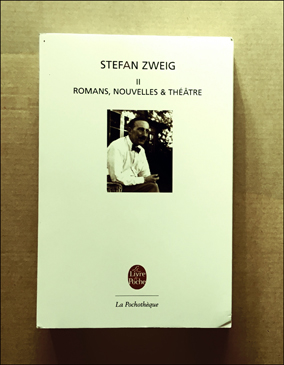 Découvrir dans un TGV « L’ivresse de la métamorphose » de Stefan Zweig, à côté d’une dame qui dévore « Cher connard » de Virginie Despentes, permet d’une certaine façon de mesurer le temps qui passe. D’autant qu’un regard de biais sur l’ouvrage de la voisine permet rapidement de détecter quelques thèmes à la mode, ceux qui font la base facile d’un succès de librairie. « L’ivresse de la métamorphose » est un roman qui mérite un arrêt aux stands. D’abord parce qu’il est posthume. Sa première parution en allemand date de 1982, quarante ans après le suicide de Zweig, ce qui nous fait quatre-vingts ans cette année. Ensuite parce qu’il n’était pas titré et que le manque a été comblé en piochant avec une belle pertinence dans la narration. En allemand cela donne « Rausch des verwandlung » mais la tonalité de la version française est plus adéquate parce que moins brutale pour nos ouïes raffinées. Et enfin, parce que Zweig n’a pas pris le temps de terminer l’histoire, laissant le soin au lecteur frustré de s’en charger.
Découvrir dans un TGV « L’ivresse de la métamorphose » de Stefan Zweig, à côté d’une dame qui dévore « Cher connard » de Virginie Despentes, permet d’une certaine façon de mesurer le temps qui passe. D’autant qu’un regard de biais sur l’ouvrage de la voisine permet rapidement de détecter quelques thèmes à la mode, ceux qui font la base facile d’un succès de librairie. « L’ivresse de la métamorphose » est un roman qui mérite un arrêt aux stands. D’abord parce qu’il est posthume. Sa première parution en allemand date de 1982, quarante ans après le suicide de Zweig, ce qui nous fait quatre-vingts ans cette année. Ensuite parce qu’il n’était pas titré et que le manque a été comblé en piochant avec une belle pertinence dans la narration. En allemand cela donne « Rausch des verwandlung » mais la tonalité de la version française est plus adéquate parce que moins brutale pour nos ouïes raffinées. Et enfin, parce que Zweig n’a pas pris le temps de terminer l’histoire, laissant le soin au lecteur frustré de s’en charger.
L’auteur sait démarrer son intrigue. Il faut dire que cela fait déjà un moment qu’il a identifié les ressorts indispensables à toute bonne histoire y compris pour ses fameuses biographies. Nous voilà d’emblée embarqués avec Christine, une jeune fille qui se morfond dans un bureau de poste autrichien où elle est auxiliaire. Elle s’y ennuie pour pas cher afin notamment de subvenir aux besoins de sa mère malade. L’action se déroule juste après la première guerre mondiale et dans ce village où elle vit, la pauvreté sévit, collant aux basques des habitants. Christine doit compter chaque schilling et chaque groschen et rien de son univers, professionnel comme privé, ne lui laisse pas le temps pour en imaginer un autre. En aurait-elle le loisir, il lui manquerait les références.
Mais voilà qu’une de ses tantes l’invite en vacances dans une chic villégiature alpine. La jeune fille pauvre y est prise en main par sa parente, ravie de jouer à la poupée pour de vrai. Elle lui achète des vêtements, des sous-vêtements plus légers que l’air, l’emmène chez le coiffeur. De retour dans sa chambre luxueuse, Christine se mire dans le miroir « enchanteur » où elle se découvre. Reflet qui lui murmure: « excellent, excellent. » Alors « dans une course joyeuse elle se hâte dans le couloir jusqu’à la chambre de sa tante, la robe fraîche et soyeuse qui l’enveloppe fait du mouvement rapide un plaisir. Elle se sent portée comme par une vague, comme par un vent divin; depuis son enfance sa démarche n’a jamais été aussi légère, si aérienne. L’ivresse de la métamorphose s’est emparée d’un être ».
Et l’expérience va s’avérer cruelle. Au contact des jolis gens qui la confondent fort logiquement avec un genre de princesse inconnue, Christine prend de l’altitude, tout le monde, hommes mûrs et jeunes gens, cherche à la séduire. Elle est dans un tourbillon de bien-être, un univers où il suffit de demander pour obtenir. Elle découvre le raffinement et oublie la pauvreté dont elle était encore accablée il y a peu. Mais au bout de quelques jours, une vilaine rumeur se met à courir dans les couloirs du palace et, craignant la déconsidération, la tante fait ses bagages, quitte précipitamment les lieux et renvoie sans plus de façons Christine à son bureau de poste où l’étouffoir administratif, sa vie modeste horriblement fidèle, l’attendent. En quelques chapitres, à moins d’être insensible, Zweig nous fait habiter le corps de Christine, c’est comme si nous y étions, de la fête à la punition. Le carrosse parfumé puis la citrouille aux relents de cuisine passé minuit, tout y est.
De retour dans son village de vains péquenots plus ou moins alcoolisés, elle dépérit d’autant plus vite qu’elle a fait connaissance avec ce monde de l’argent, dont l’échelle d’accès s’est évanouie. Lors d’une sortie avec sa sœur, elle fait la connaissance de Ferdinand, un jeune homme désenchanté ayant connu la guerre et les camps. Ils n’ont pas les moyens de s’aimer, pas l’argent nécessaire pour louer une chambre à deux. Alors ils songent froidement au suicide avant de se raviser. Ils élaborent un plan pour piquer le magot de la poste et se venger de la vie qu’on leur a imposée.
Et le roman s’arrête là, Stefan Zweig nous laisse en plan. Lui-même avait, avec sa compagne Lotte, choisi le suicide. Il ne voulait pas connaître la fin de sa propre histoire. C’est donc le break dans l’ivresse d’une métamorphose pourtant prometteuse, le milieu du repas où l’on se lève pour ne plus revenir malgré les promesses du dessert, le coitus interruptus, la disparition de soi-même, l’atrophie volontaire. Comme il l’écrivit d’ailleurs en 1931 dans une correspondance à propos d’une rédaction qui s’éternisait: « C’est Dieu qui dispose ». Et peut-être qu’au fond, son roman devait s’arrêter là, précisément où le contact avec l’inspiration avait été coupé.
PHB


C’est toujours un tel bonheur de lire Zweig et de voir qu’ici où là des lecteurs lui consacrent des chroniques. Vous me donnez envie de le relire !
Merci
Anne
merci
PS peut-être Verwandlung ?
Le thème de ce livre, tout du moins à ses débuts, pourrait être assimilé à la vie de Suzanne Marion, dite Suzy Solidor, métamorphosée par les mains expertes d’Yvonne de Brémond d’Ars .
Cf le livre » les nuits Solidor »de Charlotte Duthoo, paru au Cherche midi.
Grand merci.
(et belle découverte)
S’arrêter quand tout est possible est cruel, mais sans doute le plus cruel fut pour Zweig.
Si « C’est Dieu qui dispose », de notre temps et des évènements, il ne dispose pas des consciences, libres pas nature ou création, et libres collectivement de leur superposition, de leur enchevêtrement, de leur confrontation, de leur domination ou de leur libération réciproque.
S. Zweig nous dit peut-être, sans le savoir, qu’il n’y a pas de (bonne) conscience collective, à deux, en groupe, en classe, en peuple ou même en nation. Il n’y a que la faiblesse de chaque vie qui, partant de zéro, se construit inégalement. Et que le drame ou la tragédie est précisément de perdre dans notre conscience intime, par peur, ignorance ou passion, ce dont nous seuls disposons : notre unicité que nous seuls pouvons donner.
Il n’y a pas de conscience collective, seulement une humaine responsabilité partagée.