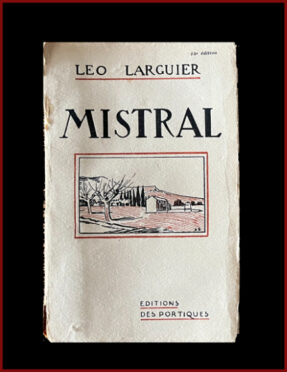 Le 14 octobre 1913, le président Poincaré s’en revenait d’Espagne où il avait visité la famille royale. Avant d’aller rejoindre son prédécesseur Émile Loubet qui s’était retiré à Montélimar, il avait fait escale à Maillane (Bouches-du-Rhône) où résidait Frédéric Mistral, un poète qui n’écrivait qu’en langue provençale, soit un authentique félibre, ainsi qu’il convenait de nommer cette catégorie. Pourquoi lui et pas un autre: au moins les habitants de son village savaient que leur concitoyen, avait obtenu le prix Nobel de littérature en 1904, faisant souffler sur la commune un vent de notoriété miraculeux. Ainsi que nous le raconte Léo Larguier (1878-1950), la servante du poète s’était affairée toute la matinée afin de polir et lustrer les meubles de la maison de Maillane et essuyé « avec un linge fin » le buste de Lamartine, l’autre poète qui avait reçu à Paris le premier. Le président était venu en train, dans l’un de ces wagons présidentiels, luxe et élégance combinés surmontant les boggies. L’un de ces wagons siglés « PR » que l’on peut visiter au musée de Mulhouse. Les gendarmes de Graveson avaient également astiqué les boutons de leur costume de cérémonie. L’air était doux et parfumé avec juste autour de Mistral, une bonne odeur de cigare.
Le 14 octobre 1913, le président Poincaré s’en revenait d’Espagne où il avait visité la famille royale. Avant d’aller rejoindre son prédécesseur Émile Loubet qui s’était retiré à Montélimar, il avait fait escale à Maillane (Bouches-du-Rhône) où résidait Frédéric Mistral, un poète qui n’écrivait qu’en langue provençale, soit un authentique félibre, ainsi qu’il convenait de nommer cette catégorie. Pourquoi lui et pas un autre: au moins les habitants de son village savaient que leur concitoyen, avait obtenu le prix Nobel de littérature en 1904, faisant souffler sur la commune un vent de notoriété miraculeux. Ainsi que nous le raconte Léo Larguier (1878-1950), la servante du poète s’était affairée toute la matinée afin de polir et lustrer les meubles de la maison de Maillane et essuyé « avec un linge fin » le buste de Lamartine, l’autre poète qui avait reçu à Paris le premier. Le président était venu en train, dans l’un de ces wagons présidentiels, luxe et élégance combinés surmontant les boggies. L’un de ces wagons siglés « PR » que l’on peut visiter au musée de Mulhouse. Les gendarmes de Graveson avaient également astiqué les boutons de leur costume de cérémonie. L’air était doux et parfumé avec juste autour de Mistral, une bonne odeur de cigare.
Léo Larguier, poète, critique, essayiste, ayant connu Apollinaire, s’était donc employé à s’insinuer dans la vie de Frédéric Mistral, ainsi qu’il l’avait fait pour Lamartine. Avec une grande liberté, de celle que l’on se donne, il avait donc supposé qu’après avoir ôté leurs chapeaux, les deux hommes s’étaient penchés pour se frotter les joues et que Mistral aurait noté que le président n’avait pas d’odeur puisqu’il ne fumait pas.
Passionnant petit ouvrage, d’une écriture aérée et inspirée, Larguier nous parle ici d’un homme à part, ayant été honoré d’un prix Nobel, à une époque où cette récompense n’était pas démonétisée comme aujourd’hui et même entrée en territoire négatif, pour employer le langage des boursiers.
Les écrivains ont le pouvoir, du moins dans les pays où c’est permis. Ils s’octroient même toutes les permissions comme celle de s’inviter alors qu’il n’était pas encore né chez Lamartine, quand Frédéric Mistral vint lui présenter « Mireille » un chant d’amour moderne en provençal et comparable à maints égards au « Cantique des cantiques » écrit en hébreu bien avant l’avènement de Jésus-Christ.
Cette fois c’est Lamartine qui a pris un petit cigare sur la cheminée. Nous sommes en 1858 et Mistral est donc venu présenter « Mirèio » soit Mireille en français. Le texte est composé de douze chants écrits sur plusieurs années. Et il sera publié l’année suivant cette visite chez l’éditeur-libraire Roumanille, rue Saint-Agricol à Avignon. Un exemplaire de ce « Pouèmo prouvençau » sera dédicacé comme de juste à Lamartine. Une œuvre puissante avec laquelle Charles Gounod composera un opéra en 1864. Il en sera même fait un film en 1933.
Ce qui est épatant dans le livre de Larguier, c’est sa capacité à nous amener dans les couloirs du temps. Non seulement pour nous raconter des événements comme la rencontre avec Poincaré ou avec Lamartine, mais aussi pour nous faire part de quelques détails inutiles mais pleins d’agrément. Comme cette déambulation de Mistral dans les rues de Paris dont certaines « sentent le péché et le parfum ». Il nous parle ainsi de cette « jeunesse dorée » dînant au Café Anglais où Mistral n’a semble-t-il pas eu l’occasion d’aller goûter ni la carpe du Rhin à la Chambord (dont la recette existe toujours) ni les « filets de sterlets à la Volga avec un coulis de crevette Bagration ».
Il était donc poète ce divin Mistral, lequel accompagnait ses textes d’une traduction française mais sans les rimes. La langue provençale parfois, se laisse néanmoins deviner sans interprète. Mais la traduction reste la bienvenue. Notamment pour savourer quelques termes destinés à brocarder une époque qui déjà avait tendance à débloquer. Dont il pouvait écrire en 1888: « En vesènt crèisse li boufiga/ E s’affaqui li bon mamèu/E se neblo li bèlli figo/E s’espoumpi li gargamèu. » Il semble que cet idiome se passait d’accent aigu, en tout cas voilà ce que cela signifiait: « En voyant croître les vessies/Se tarir les bonnes mamelles/Et se brouir les belles figues/Et s’épanouir les crétins ».
Quelque chose nous est dit ici qui résonne avec notre actualité. Et l’on ne peut que songer à cette tangente prise par le comité Nobel, s’éloignant sans cesse de l’excellence dans un esquif garni de bouffons et de vaniteux, tous alignés sur le même banc de nage: « Li foutralas », soit les « gros nigauds », comme l’on dirait du côté de Maillane.
PHB


Je crains que vous ne soyez plus jamais nobélisable, cher Philippe. Il faut savoir pratiquer la langue de bois, ce qui n’est pas votre fort. Tous mes compliments, Claude
Cher Philippe Bonnet,
Je suis un lecteur des « Soirées de Paris », appréciant beaucoup ses chroniques et particulièrement les vôtres. Cette « Visite à Mistral » a d’autant plus appelé mon attention qu’elle utilise l’ouvrage de Léo Larguier sur le grand poète provençal. Et je pense qu’il faut parler de Léo Larguier, bel écrivain (et poète bien sûr) un peu trop tombé dans l’oubli. Ces dernières années j’ai été l’auteur (en toute modestie) de deux ouvrages sur cet écrivain ( « Léo Larguier, La volupté du rêve », aux Editions de la Fenestrelle -2017- et « Léo Larguier en quelques images, de la Cévennes à Saint-Germain- des-Prés », aux Editions de La Voix Domitienne -2023-). J’ai beaucoup d’admiration pour ce jeune de La Grand’Combe (Gard) qui, fin 1899, a quitté sa Cévenne pour aller faire des études à « Science-Po », comme le souhaitaient ses parents, mais qui, en réalité, allait à Paris pour faire une carrière de poète. Et il y est parvenu, étant ensuite reconnu par les grands poètes et écrivains de son époque. Il a aussi été élu membre de l’Académie Goncourt.
Et il y a, bien sûr, la courte, mais belle amitié d’Apollinaire et Léo Larguier, amitié, je le pense, très sincère. Au front, ils échangeaient des lettres en vers. Apollinaire a offert à Léo Larguier un exemplaire du « Poète assassiné », avec cette dédicace : « A Léo Larguier, son admirateur et son ami, Guillaume Apollinaire ».
Si vous le souhaitez, je peux vous proposer, pour les « Soirées de Paris », un article sur la rencontre d’Apollinaire et de Larguier à Nîmes.
D’autre part, si vous venez à Nîmes où je réside, je serai heureux, Cher Philippe Bonnet, de vous montrer le restaurant où les deux poètes se sont retrouvés, car ils s’étaient déjà rencontrés à Paris et ensuite perdus un peu de vue. Mais ce furent, semble-t-il, de belles « retrouvailles ».
Dans le cas où ma proposition pourrait vous convenir, merci de me donner l’adresse courriel où l’on doit vous envoyer les propositions de chroniques.
Encore merci pour le plaisir que nous donnent « Les Soirées de Paris », avec mes cordiaux sentiments.
Alain ARTUS, Nîmes (alain.artus@orange.fr)
Depuis Grasse, Bellaud de la Bellaudière (1543-1588), ancêtre de Mistral (et bien connu de lui) en poésie occitane, ajoute, allant dans son sens mais au sujet de sa propre époque : « Parlo ben qui pou, fa ben qui vou ». (Parle bien qui peut, le langage est matière d’éducation, mais agis bien qui veut, la morale ressort de la volonté). La maxime est inscrite au fronton de l’un des édifices historiques de la ville, lieu de naissance et de mort du poète.