 Dans le documentaire « Le dernier samouraï » (1), Jean-Pierre Melville, grand américanophile et maître du polar sur le grand écran, déclare que pour lui, un roman policier peut être «de la pure littérature». C’est bien le cas en ce qui concerne Raymond Chandler, le père du fameux privé de Los Angeles Philip Marlowe, qui fit son apparition dans « The big sleep » en 1939.
Dans le documentaire « Le dernier samouraï » (1), Jean-Pierre Melville, grand américanophile et maître du polar sur le grand écran, déclare que pour lui, un roman policier peut être «de la pure littérature». C’est bien le cas en ce qui concerne Raymond Chandler, le père du fameux privé de Los Angeles Philip Marlowe, qui fit son apparition dans « The big sleep » en 1939.
Chandler avait alors 51 ans, mais publiait des nouvelles depuis cinq ans dans les « pulps », magazines ainsi appelés car imprimés sur du papier issu de la pulpe de bois, dont le célèbre Black Mask (dans lequel Dashiell Hammett introduisit Sam Spade).
Confinement oblige, ce fut un plaisir de me replonger dans « Le grand sommeil » , premier roman écrit (en trois mois) par celui qu’on peut considérer comme le plus grand styliste américain du roman noir, brillamment traduit en 1948 par Boris Vian pour la Série Noire.
Sachant que le père de Marlowe, né en 1888 à Chicago, abandonné par son propre père et élevé par sa mère irlandaise, fit ses études à Dulwich dans une public school (école privée comme son nom ne l’indique pas) de la banlieue londonienne, on ne s’étonne pas trop qu’il ait donné à sa créature un nom de poète anglais contemporain de Shakespeare.
D’ailleurs Chandler reconnaissait volontiers son snobisme dû à son éducation british, et cette double culture (dopée à Charles Dickens, Henry James ou Balzac) devait le pousser à observer avec une sensibilité et un cynisme redoublés son pays de naissance.
Lorsqu’il revint au pays et se retrouva à Los Angeles en 1912, la ville sembla bien provinciale au gentleman d’Hollywood, après les fastes intellectuels de Londres, Paris, Munich et Vienne. Mais cette petite ville provinciale se mit à grandir rapidement pour devenir la mégaville tentaculaire d’aujourd’hui n’ayant ni centre ni fin, et ce fut un des traits de génie du perpétuel exilé de nous faire découvrir cette mégapole de part en part sur les traces de Marlowe.
Dès « The big sleep », Los Angeles est un personnage à part entière (comme Londres pour Dickens ou Paris pour Balzac), et nous suivons le privé de rue en rue, de block en block, de quartier en quartier. Des très riches demeures des rupins de West Hollywood aux coins sordides de Griffith Park, en passant par Santa Monica rebaptisée Bay City.
Le livre s’ouvre par l’arrivée de Marlowe dans une de ces extravagantes demeures, au 3765 Alta Brea Crescent, West Hollywood : « Au-dessus des portes, de taille à laisser passer un troupeau d’éléphants hindous, un grand panneau de verre gravé représentait un chevalier en armure sombre, délivrant une dame attachée à un arbre et qui n’était revêtue que de ses longs cheveux ingénieusement disposés. »
Le reste à l’avenant : hall démesuré, escalier aérien carrelé à balustrade, brève rencontre inopinée avec une jeune fille de la maison (très) provocante lui tombant littéralement dans les bras, impeccable larbin aux cheveux gris conduisant le visiteur dans une serre aux orchidées suffocante, où l’attend le vieux général Sternwood dans son fauteuil roulant.
Le vieux général a déjà une tête de cadavre et ne se fait plus aucune illusion sur ses deux filles. Est-ce la raison pour laquelle Marlowe accepte d’enquêter sur un certain maître chanteur nommé Geiger, qui vient d’envoyer au presque moribond une reconnaissance de dettes signée Carmen, la très provocante cadette des deux filles ?
En quittant la demeure, le rude et beau Marlowe de 33 ans fera connaissance de l’autre fille à problèmes, la belle Vivian aux jambes aussi longues que son ton est autoritaire. Elle voudrait savoir ce que voulait son papa, mais se heurte à l’intégrité faite homme. D’ailleurs tout au long du livre, tandis qu’il sera aux prises avec les deux fifilles sur lesquelles le général ne se fait heureusement plus d’illusions, le très intègre Marlowe manifestera un respect total pour le vieillard aux puits de pétrole parvenu au seuil de la mort, bien différent des impitoyables richards et gangsters auxquels Marlowe-Chandler règlera son compte par la suite…
Ainsi Marlowe va-t-il nous entraîner à la recherche de Geiger, puis d’un autre maître chanteur nommé Brodie, puis du tenancier de boîte de luxe Eddie Mars, puis de son tueur Canino et « de la femme avec qui Rusty Regan ne s’est pas enfuie ».
Mais comme il le disait lui-même, Chandler n’est pas un maître de l’intrigue, et ce qui compte pour lui comme pour le lecteur, est de sillonner de part en part cette mégapole dont il nous restitue les mille atmosphères, les mille quartiers, les mille teintes du ciel, car il pleut beaucoup sur L.A., et des ombres barbotent dans le caniveau, tandis que la brume cache l’entrée des porches d’où sortent des coups de feu et que les feuillages s’égouttent sur des cadavres…
 Magnifiques peintures des lieux, dignes d’un poète, et descriptions des personnages comme on n’en a jamais vus, sans oublier des dialogues percutants suintant d’ironie.
Magnifiques peintures des lieux, dignes d’un poète, et descriptions des personnages comme on n’en a jamais vus, sans oublier des dialogues percutants suintant d’ironie.
Mais les grands stylistes n’étant pas les auteurs les plus facilement adaptables sur le grand écran, comment donc allait s’en tirer Howard Hawks, un de ces maîtres d’Hollywood capables de manier tous les genres, chargé par la Warner de tourner le film en 1946 ?
Hawks venait de révéler le couple désormais mythique Bogart-Bacall dans « To have and have not » (Le port de l’angoisse), adaptation du « plus mauvais de mes livres » dixit Hemingway.
Humphrey Bogart serait donc la première (et de loin la meilleure) incarnation de Marlowe, et sa nouvelle épouse Lauren Bacall serait Vivian, la fille aînée du vieux général, tentant constamment de protéger sa petite sœur Carmen nymphomane, érotomane et épileptique, ce qui fait beaucoup.
Bien que travaillant à Hollywood comme scénariste, notamment sur ses propres livres, Chandler ne fut pas chargé de l’adaptation de « The Big Sleep », mais on fit appel à une romancière-scénariste nommée Leigh Brackett ainsi qu’à William Faulkner (qui avait travaillé sur « Le port de l’angoisse » et faisait partie, comme Fitzgerald, Hammett ou Chandler, de l’écurie hollywoodienne des grands auteurs).
Dans la formidable biographie de Raymond Chandler signée Frank MacShane, professeur de littérature à Columbia University, nous trouvons quelques détails succulents sur l’entreprise. Après avoir rencontré Faulkner, Brackett et Bogart, le gentleman d’Hollywood, par ailleurs constamment insatisfait dans ses rapports avec l’industrie du cinéma, se déclara satisfait du scénario.
 Il suffit de revoir le film, en l’occurrence en DVD, pour comprendre cette étonnante réaction. La fidélité au livre est remarquable. Pour un écrivain estimant ne pas être très intéressé par l’intrigue, il y a de quoi être satisfait : jusque vers la fin, l’enchaînement des scènes (assez tarabiscoté) est rigoureusement celui du livre, les personnages sont les mêmes, les dialogues constamment repris au mot près.
Il suffit de revoir le film, en l’occurrence en DVD, pour comprendre cette étonnante réaction. La fidélité au livre est remarquable. Pour un écrivain estimant ne pas être très intéressé par l’intrigue, il y a de quoi être satisfait : jusque vers la fin, l’enchaînement des scènes (assez tarabiscoté) est rigoureusement celui du livre, les personnages sont les mêmes, les dialogues constamment repris au mot près.
Détail amusant dans le livre de MacShane : lorsque le cinéaste envoie un télégramme pour lui demander qui a tué le chauffeur des Sternwood, Chandler lui répond : « Je l’ignore. » Comme dans le livre, le mystère restera entier.
Bien sûr, on ne retrouve pas les merveilleuses descriptions de personnages et de paysages, pas plus que les déambulations de Marlowe dans Los Angeles, car Howard Hawks a choisi de se concentrer sur les scènes d’intérieur. Mais Chandler dira que le cinéaste « avait le don de créer une atmosphère et d’apporter la note délibérée de sadisme ».
Et bien sûr, on a ménagé plus de place à l’idylle entre Marlowe et Vivian, soit Bogart-Bacall, et transformé radicalement deux ou trois scènes à la fin pour la faire mousser. Mais Chandler fut enchanté par la performance de Bogart, qui peut « être un dur même sans arme », comme on disait à Hollywood. « De plus, écrivait-il, son sens de l’humour a une nuance grinçante de mépris. Bogart est une nature. »
De rares compliments venant du gentleman d’Hollywood à l’esprit critique très affuté.
Lise Bloch-Morhange
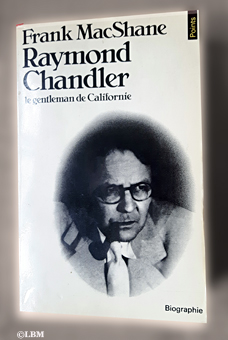 « Le grand sommeil », Raymond Chandler, traduction Boris Vian 1948, folio policier, Gallimard, 2002
« Le grand sommeil », Raymond Chandler, traduction Boris Vian 1948, folio policier, Gallimard, 2002
DVD « Le Grand Sommeil », Howard Hawks, WB
« Raymond Chandler, le gentleman de Californie », Frank MacShane , Balland, 1984
(1) Diffusé sur Arte le 29 mars et visible en replay jusqu’au 27 mai (voir l’article du 6 avril, « Le dernier Samourai)


Chère Lise,
désolé de vous contredire : mais ce n’est pas Bogart qui fut le premier Philip Marlowe… mais Dick Powell, dans « Farewell, my lovely » d’Edward Dmytryk… en 1944…
Quant à Leigh Brackett, c’est elle la vraie scénariste (efficace)… Avec son mari Charles, elle a aussi écrit le scénario de Rio Bravo, toujours de HH… et pour continuer, elle a écrit un autre scénario d’après Chandler, « The Long Goodbye », un des premiers grands films de Robert Altman avec Elliott Gould en Marlowe…
Quand vous me demandiez quel réalisateur j’aimais, un jour où je démolissais les fausses valeurs comme Scorsese ou Eastwood, je n’ai pas eu le réflexe de cite Altman.
Il est actuellement au purgatoire… et pourtant c’est le plus grand avec Bergman… Il a tout abordé, n’a pas hésité à faire du théâtre filmé, a livré des nanars épouvantables entre deux chefs d’oeuvre… De Mash à The Last Show, c’est un parcours jamais calculé, sans redites. Qui croirait que l’auteur de Popeye est aussi celui de Gosford Park ? de Short Cuts ? de Nashville ?
Ah… Un dernier point sur Leigh Brackett. Avant sa mort elle a écrit la première mouture de Star Wars ! Lucas prétend avoir tout refait mais faut-il le croire ?
Sorry, cher Philippe, pour l’erreur à deux ans près sur Dick Powell, que j’aime beaucoup (plus que Dmytryk…)….
Effectivement Mrs Leigh Brackett est la vraie scénariste de « Big Sleep », c’est elle dont parle Chandler dans ses lettres, et pas de Faulkner. Bien que la Warner ait tropillé sa fin qui plaisait à Chandler.
« The Long Goodbye » est à mon avis un film pas très chandlérien, mais je suis d’accord avec vous sur Altman, plus aimé en France parce que trop critique de l’Amérique.
Ce qui ne m’empêche pas, comme vous le savez, de considérer aussi Scorsese comme un grand qui, lui aussi, a abordé tous les genres, de » Mean Streets » à « Ragging Bull » à « The Age of Innocence », l’écart est aussi grand sinon plus que Altman.
Ce n’est que mon humble avis…. Bon confinement à vous!
Bon confinement, aussi !
et mes amitiés sincères.