 Ils en avaient de la chance les écoliers en 1936, lorsqu’ils étudiaient la géographie. Le géographe Jean Brunhes, pour la conception de son cours supérieur, était parti du principe que cette matière devait être attrayante, cartographie comprise. Concernant les vues de paysages du monde, il avait mobilisé l’artiste Roger Broders, lequel s’était employé à réaliser des représentations de paysages propres à faire rêver un petit garçon ou une petite fille. L’autre aspect extraordinaire de cette édition destinée au primaire et qui en apprendrait sûrement de nos jours à des diplômés de Sciences Po, c’est que pour sa couverture et sa quatrième de couverture, l’artiste breton Mathurin Méheut (1882-1958) fut mobilisé. En l’occurrence afin d’illustrer la mer, surface du globe à laquelle Jean Brunhes accordait une grande importance stratégique. En haut à gauche de cette illustration de prestige, figurent d’ailleurs dans un cercle les deux « M » enlacés, signature bien connue de ce natif de Lamballe dans les Côtes d’Armor. Continuer la lecture
Ils en avaient de la chance les écoliers en 1936, lorsqu’ils étudiaient la géographie. Le géographe Jean Brunhes, pour la conception de son cours supérieur, était parti du principe que cette matière devait être attrayante, cartographie comprise. Concernant les vues de paysages du monde, il avait mobilisé l’artiste Roger Broders, lequel s’était employé à réaliser des représentations de paysages propres à faire rêver un petit garçon ou une petite fille. L’autre aspect extraordinaire de cette édition destinée au primaire et qui en apprendrait sûrement de nos jours à des diplômés de Sciences Po, c’est que pour sa couverture et sa quatrième de couverture, l’artiste breton Mathurin Méheut (1882-1958) fut mobilisé. En l’occurrence afin d’illustrer la mer, surface du globe à laquelle Jean Brunhes accordait une grande importance stratégique. En haut à gauche de cette illustration de prestige, figurent d’ailleurs dans un cercle les deux « M » enlacés, signature bien connue de ce natif de Lamballe dans les Côtes d’Armor. Continuer la lecture
Archives
Catégories
- Anecdotique
- Apollinaire
- Architecture
- BD
- Cinéma
- Danse
- Découverte
- Documentaire
- Enchères
- Essai
- Exposition
- Gourmandises
- Histoire
- Humeur
- Jardins
- Livres
- Mode
- Musée
- Musique
- Non classé
- Nouvelle
- Peinture
- Philosophie
- Photo
- Poésie
- Politique
- Portrait
- Presse
- Publicité
- Radio
- récit
- Société
- Spectacle
- Style
- Surprises urbaines
- Télévision
- Théâtre
Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

 Là où il aurait fallu Jacques-Bénigne Bossuet (1), il y eut Emmanuel Macron et Rachida Dati. Le Président de la République, relevant que Brigitte Bardot « incarnait une vie de liberté », précisa « nous pleurons une légende du siècle ! ». La ministre de la Culture, de son côté, salua « une icône parmi les icônes », qu’elle jugea « follement libre et tellement française, finalement! ». Leurs commentaires ouvraient, ce 28 décembre 2025, un deuil médiatique. Il s’agit d’un cérémonial rarement pratiqué dans son intégralité. Toute vedette défunctant, n’y accède pas nécessairement. La sélection, rigoureuse, se fonde sur des critères très sélectifs, personnalité suffisamment typée, silhouette immédiatement identifiable, carrière légendaire, surnom devenu synonyme, répertoire poly-diffusé, inscription au registre des gloires nationales empaillées de leur vivant… À l’instar de Jean-Philippe Smet, Brigitte Bardot bénéficiait de cet adjectif. On disait « notre B.B nationale », comme « notre Johnny national ». Elle était l’ultime, depuis le départ de Belmondo et Delon.
Là où il aurait fallu Jacques-Bénigne Bossuet (1), il y eut Emmanuel Macron et Rachida Dati. Le Président de la République, relevant que Brigitte Bardot « incarnait une vie de liberté », précisa « nous pleurons une légende du siècle ! ». La ministre de la Culture, de son côté, salua « une icône parmi les icônes », qu’elle jugea « follement libre et tellement française, finalement! ». Leurs commentaires ouvraient, ce 28 décembre 2025, un deuil médiatique. Il s’agit d’un cérémonial rarement pratiqué dans son intégralité. Toute vedette défunctant, n’y accède pas nécessairement. La sélection, rigoureuse, se fonde sur des critères très sélectifs, personnalité suffisamment typée, silhouette immédiatement identifiable, carrière légendaire, surnom devenu synonyme, répertoire poly-diffusé, inscription au registre des gloires nationales empaillées de leur vivant… À l’instar de Jean-Philippe Smet, Brigitte Bardot bénéficiait de cet adjectif. On disait « notre B.B nationale », comme « notre Johnny national ». Elle était l’ultime, depuis le départ de Belmondo et Delon.  Quand Guillaume Apollinaire écrivait qu’il souhaitait dans sa maison « une femme ayant sa raison, un chat passant parmi les livres » et « des amis en toute saison », on comprend bien, dans cet extrait du « Bestiaire », qu’il s’agissait d’un vœu. Cette chose que l’on exprime beaucoup pour Noël et la fin de l’année. Lorsque nous souhaitons, il s’agit bien de la plus faible expression de notre volonté et l’entendeur ne s’en sentira nullement obligé. Si Apollinaire au contraire avait « exigé », une « femme ayant sa raison », il aurait exprimé au passage un peu de mauvaise humeur. S’il avait enjoint un interlocuteur de lui fournir « des amis en toute saison » avec menace de pénalités de retard et mobilisation d’un huissier, tout le monde aurait été d’accord pour noter un net changement de ton. Et en cas de sommation, il y aurait eu échange de bristols, convocation sur le pré avec le choix des armes et témoins certifiés. C’est pourquoi nous vous informons cher lectorat des Soirées de Paris, avec toute l’aménité requise, que nos publications s’interrompent céans et reprendront dès le 5 janvier, tout en vous priant d’agréer nos bonnes pensées pour vous et vos proches. PHB
Quand Guillaume Apollinaire écrivait qu’il souhaitait dans sa maison « une femme ayant sa raison, un chat passant parmi les livres » et « des amis en toute saison », on comprend bien, dans cet extrait du « Bestiaire », qu’il s’agissait d’un vœu. Cette chose que l’on exprime beaucoup pour Noël et la fin de l’année. Lorsque nous souhaitons, il s’agit bien de la plus faible expression de notre volonté et l’entendeur ne s’en sentira nullement obligé. Si Apollinaire au contraire avait « exigé », une « femme ayant sa raison », il aurait exprimé au passage un peu de mauvaise humeur. S’il avait enjoint un interlocuteur de lui fournir « des amis en toute saison » avec menace de pénalités de retard et mobilisation d’un huissier, tout le monde aurait été d’accord pour noter un net changement de ton. Et en cas de sommation, il y aurait eu échange de bristols, convocation sur le pré avec le choix des armes et témoins certifiés. C’est pourquoi nous vous informons cher lectorat des Soirées de Paris, avec toute l’aménité requise, que nos publications s’interrompent céans et reprendront dès le 5 janvier, tout en vous priant d’agréer nos bonnes pensées pour vous et vos proches. PHB 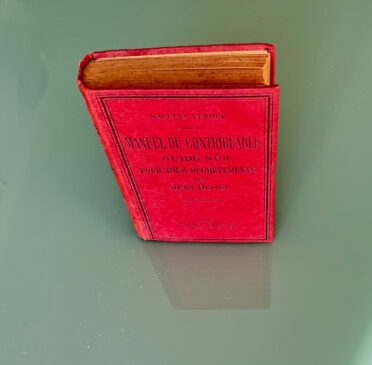 Il valait mieux jouer au billard à Tarascon plutôt qu’à Paris. Dans le premier cas la taxe était de 15 francs, dans l’autre elle grimpait à soixante. En 1871, année de la Commune, il s’agissait de trouver de nouveaux impôts et, ce faisant, de déterminer les signes extérieurs de richesse. Comme quoi la créativité en la matière ne date pas d’hier, au moment où se déchaînent les imaginations dans le but de capter toujours plus de blé. Le billard était donc un marqueur et l’idée était de « frapper l’aisance des particuliers » ayant suffisamment d’espace pour en avoir un. C’est pourquoi, ainsi que l’explique un « Guide du contribuable » remontant au tout début du 20e siècle, le législateur dans sa sage mansuétude, avait pris en compte qu’il était moins cher pour la pratique du billard, de disposer d’espace en province et que par conséquent, le prélèvement se devait d’être allégé par rapport aux grandes villes. Édité par la maison Vermot « Le manuel du contribuable, guide sûr pour tous dégrèvements », avait pour auteur est un certain Jean Fisc, histoire de se détendre. Il démontrait page à page, la soif inextinguible de l’État, en cette matière toujours d’actualité.
Il valait mieux jouer au billard à Tarascon plutôt qu’à Paris. Dans le premier cas la taxe était de 15 francs, dans l’autre elle grimpait à soixante. En 1871, année de la Commune, il s’agissait de trouver de nouveaux impôts et, ce faisant, de déterminer les signes extérieurs de richesse. Comme quoi la créativité en la matière ne date pas d’hier, au moment où se déchaînent les imaginations dans le but de capter toujours plus de blé. Le billard était donc un marqueur et l’idée était de « frapper l’aisance des particuliers » ayant suffisamment d’espace pour en avoir un. C’est pourquoi, ainsi que l’explique un « Guide du contribuable » remontant au tout début du 20e siècle, le législateur dans sa sage mansuétude, avait pris en compte qu’il était moins cher pour la pratique du billard, de disposer d’espace en province et que par conséquent, le prélèvement se devait d’être allégé par rapport aux grandes villes. Édité par la maison Vermot « Le manuel du contribuable, guide sûr pour tous dégrèvements », avait pour auteur est un certain Jean Fisc, histoire de se détendre. Il démontrait page à page, la soif inextinguible de l’État, en cette matière toujours d’actualité.  Quelle étrangeté que cette salle Cortot, petite merveille de 400 places située dans un coin perdu du dix-septième arrondissement de Paris. Tout s’explique quand on voit qu’elle est attenante à l’imposante École Normale de Musique de Paris, école supérieure privée fondée en 1919 par le pianiste-pédagogue suisse Alfred Cortot et le critique musical Auguste Mangeot. Les noms les plus illustres seront attachés à l’École (Nadia Boulanger, Pablo Casals, Stravinsky, Rostropovitch et tutti quanti comme professeurs), tandis que Cortot a l’heureuse idée de demander à Auguste Perret de construire une salle de concert à l’emplacement des écuries en 1928. Le roi du béton armé vient d’édifier le Théâtre des Champs-Élysées d’un modernisme Art déco raffiné (et concevra bientôt le Palais d’Iéna), et propose bien sûr à Cortot une structure en béton.
Quelle étrangeté que cette salle Cortot, petite merveille de 400 places située dans un coin perdu du dix-septième arrondissement de Paris. Tout s’explique quand on voit qu’elle est attenante à l’imposante École Normale de Musique de Paris, école supérieure privée fondée en 1919 par le pianiste-pédagogue suisse Alfred Cortot et le critique musical Auguste Mangeot. Les noms les plus illustres seront attachés à l’École (Nadia Boulanger, Pablo Casals, Stravinsky, Rostropovitch et tutti quanti comme professeurs), tandis que Cortot a l’heureuse idée de demander à Auguste Perret de construire une salle de concert à l’emplacement des écuries en 1928. Le roi du béton armé vient d’édifier le Théâtre des Champs-Élysées d’un modernisme Art déco raffiné (et concevra bientôt le Palais d’Iéna), et propose bien sûr à Cortot une structure en béton.  Il est des livres qui se lisent comme un souffle, simples à l’œil mais profonds à l’âme. « La Faute d’Orthographe est ma langue maternelle » (sorti en 2012 par Daniel Picouly), en fait partie. Entre poésie et prose, l’auteur nous emmène dans un univers où les mots trébuchent, se relèvent et rigolent, comme s’ils racontaient une histoire plus insolite que l’histoire elle-même. Le titre, à lui seul, m’a immédiatement attirée. En tant que lectrice indienne cherchant et sculptant sa voix dans l’expression française, je savais qu’il parlerait à ma curiosité et à mes tentatives de faire cohabiter ma culture, mes souvenirs et ma langue choisie. Ce petit bouquin m’a touchée et amusée à la fois: il est tendre, malicieux, et pourtant chargé de cette profondeur que l’on découvre seulement lorsque l’on prend le temps de savourer chaque mot.
Il est des livres qui se lisent comme un souffle, simples à l’œil mais profonds à l’âme. « La Faute d’Orthographe est ma langue maternelle » (sorti en 2012 par Daniel Picouly), en fait partie. Entre poésie et prose, l’auteur nous emmène dans un univers où les mots trébuchent, se relèvent et rigolent, comme s’ils racontaient une histoire plus insolite que l’histoire elle-même. Le titre, à lui seul, m’a immédiatement attirée. En tant que lectrice indienne cherchant et sculptant sa voix dans l’expression française, je savais qu’il parlerait à ma curiosité et à mes tentatives de faire cohabiter ma culture, mes souvenirs et ma langue choisie. Ce petit bouquin m’a touchée et amusée à la fois: il est tendre, malicieux, et pourtant chargé de cette profondeur que l’on découvre seulement lorsque l’on prend le temps de savourer chaque mot.  Sous le titre « Immortel Gotlib », le Figaro magazine (21.11.2025) annonçait la parution prochaine de « l’œuvre complète de l’immense Marcel Gotlib ». Loué soit Yehova Adonaï!
Sous le titre « Immortel Gotlib », le Figaro magazine (21.11.2025) annonçait la parution prochaine de « l’œuvre complète de l’immense Marcel Gotlib ». Loué soit Yehova Adonaï! Pas étonnant que les notes de « Misty » avaient l’air de tomber du ciel. C’était un jour de 1954. Le pianiste Erroll Garner voyageait entre San Francisco et Chicago. Il regardait le paysage aérien, le ciel, les nuages, l’arc-en-ciel à travers le filtre d’un hublot embué. C’est ainsi qu’il composa « Misty », l’un des titres les plus joués de l’histoire du jazz. Si le titre d’un documentaire qui débarque en fin de semaine sur Arte manque un peu d’imagination (« Le swing au bout des doigts »), son contenu est une bénédiction, presque une messe pour tous ceux qui aiment Garner, géant autodidacte ne toisant qu’un mètre cinquante sept. Ce pourquoi au passage et en tournée, il trimballait un vieil annuaire qui lui permettait d’être à la bonne hauteur du clavier. Signé Georges Gachot, ce film a de surcroît le bon goût de durer plus d’une heure et demie. Un régal qu’à peine visionné on reprogrammera sur sa télé du 14 décembre au 12 janvier.
Pas étonnant que les notes de « Misty » avaient l’air de tomber du ciel. C’était un jour de 1954. Le pianiste Erroll Garner voyageait entre San Francisco et Chicago. Il regardait le paysage aérien, le ciel, les nuages, l’arc-en-ciel à travers le filtre d’un hublot embué. C’est ainsi qu’il composa « Misty », l’un des titres les plus joués de l’histoire du jazz. Si le titre d’un documentaire qui débarque en fin de semaine sur Arte manque un peu d’imagination (« Le swing au bout des doigts »), son contenu est une bénédiction, presque une messe pour tous ceux qui aiment Garner, géant autodidacte ne toisant qu’un mètre cinquante sept. Ce pourquoi au passage et en tournée, il trimballait un vieil annuaire qui lui permettait d’être à la bonne hauteur du clavier. Signé Georges Gachot, ce film a de surcroît le bon goût de durer plus d’une heure et demie. Un régal qu’à peine visionné on reprogrammera sur sa télé du 14 décembre au 12 janvier.  Décidément, l’éternelle question de la mise en scène contemporaine des opéras ne cesse de trop souvent nous accabler. Il faut dire que la vie des directeurs de salles est bien difficile! Prenez Baptiste Charroing (45 ans), le tout nouveau patron de la magnifique nef Art déco du théâtre des Champs Élysées, rutilante de rouge et or. Ancien directeur de production in loco, pour sa première saison, proclamant son amour de la jeunesse, il pensait faire un coup d’éclat en demandant à la jeune italienne Silvia Costa (41 ans) de monter la redoutable « Damnation de Faust » de Berlioz. La jeune autrice-metteure-en-scène-scénographe-interprète, très versée dans les œuvres contemporaines, soi-disant connue pour « pour réinventer l’opéra » (lourde réputation, tout le monde veut réinventer l’opéra), a longtemps hésité avant d’accepter. Mais peut-être pas assez longtemps, « La damnation de Faust » étant quasiment irreprésentable à la scène.
Décidément, l’éternelle question de la mise en scène contemporaine des opéras ne cesse de trop souvent nous accabler. Il faut dire que la vie des directeurs de salles est bien difficile! Prenez Baptiste Charroing (45 ans), le tout nouveau patron de la magnifique nef Art déco du théâtre des Champs Élysées, rutilante de rouge et or. Ancien directeur de production in loco, pour sa première saison, proclamant son amour de la jeunesse, il pensait faire un coup d’éclat en demandant à la jeune italienne Silvia Costa (41 ans) de monter la redoutable « Damnation de Faust » de Berlioz. La jeune autrice-metteure-en-scène-scénographe-interprète, très versée dans les œuvres contemporaines, soi-disant connue pour « pour réinventer l’opéra » (lourde réputation, tout le monde veut réinventer l’opéra), a longtemps hésité avant d’accepter. Mais peut-être pas assez longtemps, « La damnation de Faust » étant quasiment irreprésentable à la scène.  Ces deux-là devaient se croiser du regard avec une mimique de défi, nuancée d’un brin d’admiration réciproque. Aujourd’hui enveloppée de papier blanc, couchée dans une boîte en carton, conservée à la BHVP, cette statuette bordait autrefois le fleuve Sépik, en Papouasie Nouvelle Guinée, avant de faire un demi-tour du monde et d’atterrir dans l’appartement de Guillaume Apollinaire au 202 boulevard Saint-Germain à Paris. Oui, les deux devaient se toiser, ayant chacun des accointances avec l’au-delà et les mondes réputés imperceptibles. Si la statuette est vraiment de 1900 comme indiqué sur la référence, elle serait de 20 ans la cadette du poète, ce qui ne l’empêche guère d’exprimer 3000 ans de culture fluviale et d’habitations sur pilotis. Il se trouve qu’il y a dix ans en ce moment-même, le musée du Quai Branly exposait ses collections du Sepik, dévoilant ce faisant un monde fort mal connu, ainsi qu’en témoignait par exemple le film « La vallée » de Barbet Schroeder, en 1972. Déjà Bulle Ogier, actrice principale, s’aventurait sur ces territoires encore résistants à la culture blanche, pour y glaner des plumes rares, avec les PinkFloyd en musique d’accompagnement.
Ces deux-là devaient se croiser du regard avec une mimique de défi, nuancée d’un brin d’admiration réciproque. Aujourd’hui enveloppée de papier blanc, couchée dans une boîte en carton, conservée à la BHVP, cette statuette bordait autrefois le fleuve Sépik, en Papouasie Nouvelle Guinée, avant de faire un demi-tour du monde et d’atterrir dans l’appartement de Guillaume Apollinaire au 202 boulevard Saint-Germain à Paris. Oui, les deux devaient se toiser, ayant chacun des accointances avec l’au-delà et les mondes réputés imperceptibles. Si la statuette est vraiment de 1900 comme indiqué sur la référence, elle serait de 20 ans la cadette du poète, ce qui ne l’empêche guère d’exprimer 3000 ans de culture fluviale et d’habitations sur pilotis. Il se trouve qu’il y a dix ans en ce moment-même, le musée du Quai Branly exposait ses collections du Sepik, dévoilant ce faisant un monde fort mal connu, ainsi qu’en témoignait par exemple le film « La vallée » de Barbet Schroeder, en 1972. Déjà Bulle Ogier, actrice principale, s’aventurait sur ces territoires encore résistants à la culture blanche, pour y glaner des plumes rares, avec les PinkFloyd en musique d’accompagnement.